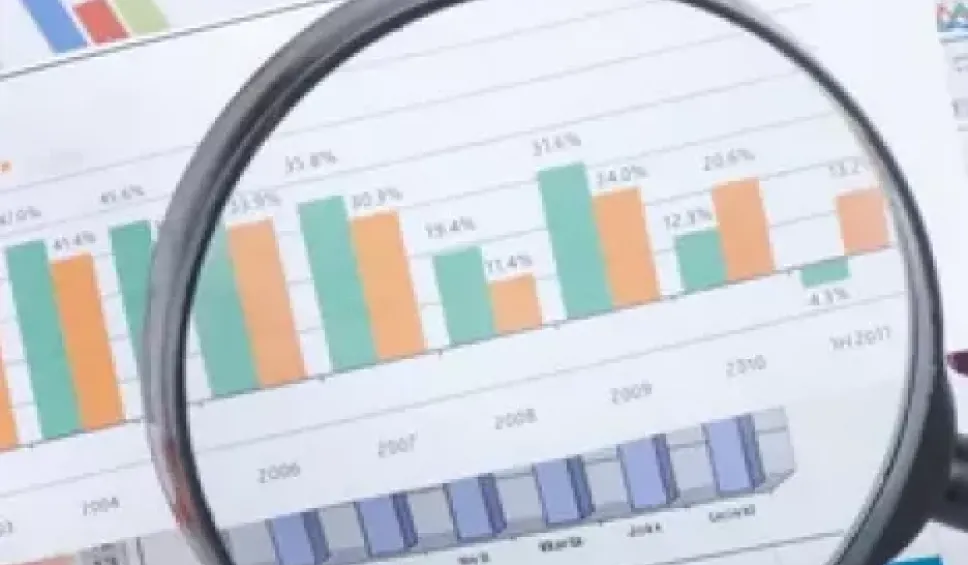
- Les chiffres du chômage
-
Le taux de chômage et le nombre de demandeurs d’emploi : aucun exploit historique !
Olivier Dussopt, Ministre du Travail, le 17 mai dernier, s’est réjoui du niveau record de taux de chômage exceptionnellement bas1. Tentons d’y voir un peu plus clair dans cette communication d’autocongratulation du gouvernement. Pour apprécier le phénomène du chômage deux relevés statistiques sont couramment utilisés : le taux de chômage au sens du Bureau International du Travail (BIT) évalué par l’enquête emploi de l’INSEE et le nombre de chômeurs inscrits au service public de l’emploi (Pôle emploi) selon le nombre d’heures d’activité validées par ces demandeurs dans le mois. Nous vous proposons dans l’encadré ci-dessous un éclairage sur ces deux façons de mesurer le chômage.
Méthodo sur les deux principales statistiques du chômage en France :
L’enquête emploi INSEE est un sondage auprès d’une population représentative des résidents en France qui calcule le nombre de chômeurs selon les critères du BIT 2(divisé par la population active pour obtenir le taux de chômage).
Le nombre de chômeurs est comptabilisé par Pôle emploi (Pe) selon le nombre d’inscrits au sein de ses services dans ses différentes catégories (ABCDE)3 qui correspondent à un niveau d’activité réalisé par le demandeur dans le mois de référence.
La différence entre le nombre de chômeurs de catégorie A et le nombre de chômeurs au sens du BIT dépend de la quantité de chômeurs qui font des démarches de recherche (candidatures) sans passer par le service public de l’emploi (cas 1) et, à l’inverse, de la quantité de chômeurs inscrits à Pe qui n’ont pas candidaté à un emploi (cas 2). La simple inscription au sein du service public de l’emploi ne suffit pas à être considéré comme chômeur au sens du BIT et le fait de candidater à un emploi sans l’appui de Pe ne permet pas d’être comptabilisé par celui-ci. L’écart de ces deux statistiques est croissant depuis 2015 et fait l’objet d’une documentation abondante.4 Le ratio « cas 1/cas 2 » tend à diminuer avec le vieillissement de la population active et l’allongement de l’âge moyen de départ en retraite qui tend à maximiser le cas 2 (chômeurs en attente de liquidation de leur retraite).
En utilisant ces deux statistiques, on s’aperçoit que les chiffres du chômage sont bons mais ne sont pas aussi exceptionnels que le prétend le gouvernement (voir graphique ci-dessous). Si la baisse du nombre de chômeurs de catégorie A est en diminution, cela n’est pas le cas des catégories B et C. Ainsi, le nombre de chômeurs (catégorie ABC) est semblable à celui du milieu des années 2010 et le taux de chômage au sens du BIT est quant à lui proche de celui enregistré après la crise de 2008.
- Emploi et territoires
-
Des disparités territoriales de dynamique de l’emploi qui rendent d’autant plus absurde la récente réforme de l’assurance-chômage
La récente réforme de l’assurance chômage réduit la durée d’indemnisation de 25% (en respectant toutefois 6 mois de durée d’indemnisation minimum), lorsque le taux de chômage national passe sous la barre des 9%. Or, les chiffres du chômage sont sensiblement différents sur le territoire. Par exemple, au quatrième trimestre 2022 selon l’INSEE5, Les Pyrénées-Orientales connaissent un taux de chômage de 11.7%, le Nord de 9.2%, la Seine-Saint-Denis de 10.1% quand il est de5.6% à Paris et de 4.1% dans le Cantal. Ces inégalités de taux de chômage dans les territoires relèvent de différences notables de composition démographique et de dynamisme économique. De manière générale, les départements dont la population est plus jeune ont des taux de chômage plus importants et ceux dont l’activité économique est plus dynamique connaissent des taux de chômage plus bas.

5 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2012804#graphique-TCRD_025_tab1_departements
Selon la DARES6, les dynamiques régionales du nombre de chômeurs varient également au premier trimestre 2023, par exemple la Région Ile-de-France a connu une décrue du nombre de chômeurs alors qu’il augmente en Normandie ou en Guyane. La CGT s’oppose à toute modulation de la durée d’indemnisation selon le taux de chômage mais il faut constater que ces différences territoriales tordent le cou à l’argumentaire gouvernemental. En effet, si on entrait dans leur logique de « seuil de responsabilité face au chômage », le gouvernement devrait alors modifier les règles d’indemnisation selon les situations éco-démographiques de chaque territoire !
La France attire les Investissements Directs Étrangers (IDE) sur ses territoires mais sont peu créateurs
d’emplois
Le 12 mai dernier s’est installé à Dunkerque, le taïwanais Prologium Technology, dont l’usine géante (gigafactory) de batteries électriques pèse 3 000 emplois. Macron s’est félicité de cette implantation notamment lors de son interview au 20H de TF1 du 15 mai dernier1. De plus, le cabinet EY classe première la France pour son attractivité des IDE. Seulement, cet exemple n’est pas représentatif. Il s’agit souvent d’investissement peu créateurs d’emplois contrairement à nos voisins européens. Ainsi un IDE en France créé environ 33 emplois chez nous contre 58 en Allemagne et même 326 en Espagne7. La France est attractive du fait des aides fiscales qu’elle consent aux entreprises8, encore faudrait-il les conditionner à la création d’emplois.
- Les contours de l’emploi
-
À la frontière du chômage et de l’inactivité : la croissance du halo du chômage est inquiétante dans un contexte de réforme du RSA.
L’enquête emploi INSEE permet aussi de mesurer le nombre de personnes sans emploi souhaitant travailler mais qui ne sont pas immédiatement disponibles pour occuper ou rechercher un emploi9. Cette population entre chômage et inactivité constitue le halo du chômage et représente 2 millions de personnes. Ce nombre est sur une tendance croissante depuis 2008 et a connu deux pics : l’un en 2019 de 20% et l’autre en 2020 de 45 % en conséquence de la crise sanitaire. Passé ce deuxième pic COVID, le halo repart sur unedynamique de croissance sur ces derniers trimestres : +62 000 au T1/2023 et +49 000 au T2/2022. L’accroissement considérable de cette population souvent précaire est à mettre en lien avec l’augmentation du nombre de bénéficiaires des minimas sociaux (+57 % de 1999 à 2020). Dans ce contexte d’accroissement de la précarité, la CGT s’oppose au projet de loi « plein-emploi » qui vise à allouer le RSA qu’en contrepartie de 20H de travail hebdomadaire sans aucuns droits sociaux. Cette réforme ferait alors émerger une nouvelle catégorie de travailleurs sans droits et concurrente des salariés classiques. Enfin, elle priverait, les bénéficiaires actuels qui ne peuvent pas travailler, de cette ressource pourtant indispensable à leur survie.
L’Autorité des Relations sociales des Plateformes d'Emploi (ARPE) entérine le modèle de l’auto- entreprenariat.
Le 20 avril dernier, un accord a été signé par l'API (Association des plateformes d'indépendants) et plusieurs organisations syndicales qui impose le statut d’autoentrepreneur aux livreurs à vélo tout en maintenant une rémunération de 11€75 de l’heure. Cette rémunération ne prend pas en considération les temps d’attente entre deux commandes, ce qui revient à une rémunération bien inférieure au SMIC. La CGT dénonce cet accord indigne et la stratégie patronale de l'API qui souhaite, par tous les moyens nécessaires, entériner un modèle social défavorable aux travailleurs avec le soutien du gouvernement. De plus, au niveau de l’Union Européenne, ce 12 juin, le Conseil de l’Europe s’est montré plus restrictif que la proposition de directive du Parlement européen de décembre dernier sur le nombre de critères de définition de la subordination des travailleurs aux plateformes et la présomption de relation salariale qui en découle. Le Conseil doit désormais ouvrir des négociations avec le Parlement européen afin de parvenir à un accord final sur le projet de directive, affaire à suive…
- Les prévisions économiques de l’e mp loi
-
La France suit la tendance des pays de l’OCDE : l’emploi résiste malgré une
croissance atone
Dans tous les pays de l’OCDE, on observe des courbes de taux de chômage assez similaires (voir graphique ci-dessous)10. Excepté aux États-Unis, la diminution de l’activité liée à la crise du COVID n’a pas fait exploser le taux de chômage du fait des plans d’aide mis en place par tous les États. Puis la reprise a été incertaine du fait de deux problèmes d’approvisionnement successifs11 : la première liée à la politique zéro Covid chinoise et la deuxième liéeà la crise géopolitique consécutive au conflit ukrainien. Malgré une croissance limitée, les chiffres de l’emploi sont plutôt bons dans tous les pays. Les carnets de commandes des entreprises sont bien remplis. Elles maintiennent alors les emplois même dans une situation de sous- production, comme des coureurs sur leur starting- block en attendant le coup de sifflet qui mettra fin aux problèmes de ressources. Selon l’OFCE, cette tendance d’une faible croissance avec un maintien de l’emploi va se poursuivre à moyen terme pour
atteindre, en 2023, 0.8% de croissance du PIB pour 7.4% de taux de chômage12, et en 2024, 1.2% de croissance pour un taux de chômage légèrement en hausse à 7.9%13. Ce léger retournement du marché du travail s’observe déjà dans les chiffres souvent annonciateurs de l’emploi intérimaire qui commence à se replier (-2.4% sur un an) en ce début d’année 202314. Cependant, la conséquence de cette « surdotation en emploi » relativement à la production est une dégradation de la productivité, c’est- à-dire une diminution de la production relativement au nombre de personnes en emploi. Cette situation est financièrement soutenable pour les entreprises car elles ont bénéficié ou continuent de bénéficier d’aides publiques importantes liées au maintien de l’emploi même après la crise COVID. De plus, elles ont augmenté leur prix (inflation) dans des proportions plus importantes que leur coût (surprofit). En France, au niveau des aides publiques, le chômage partiel a permis de maintenir les emplois tout en préservant la liquidité des entreprises, et le dispositif massif d’aide à l’apprentissage, en partie maintenu15, a permis de diminuer les statistiques du chômage des jeunes sans d’ailleurs les insérer nécessairement de manière pérenne sur le marché de l’emploi16.
- Du côté des branches
-
L’emploi en France, largement tiré par le secteur tertiaire marchand
L’évolution du nombre de personnes en emploi en France est largement expliquée par la dynamique de l’emploi dans le secteur tertiaire marchand comme le commerce, l’hôtellerie et la restauration17. L’évolution du nombre d’emplois dans ce secteur a été très marqué par les confinements et déconfinements successifs liés à la crise sanitaire de T1/2020 à T2/2021. Depuis, le nombre d’emplois pourvus dans ces secteurs diminue mais reste positif. Aussi ce dernier trimestre (T1/2023) un nombre important d’offres durables d’emploi correspondent à ces secteurs (92 730 emplois dans le commerce/vente et grande distribution, 71 570 sur l’hôtellerie restauration, 76 710 dans les activités de support aux entreprises18. Malgré le fait que le tertiaire marchand crée des emplois, rappelons que, contrairement à ce que raconte la propagande gouvernementale, le nombre d’offre d’emploi reste bien inférieur au nombre de chômeurs. La crise des pénuries d’emploi reste donc un mythe patronal à déconstruire19 ! -