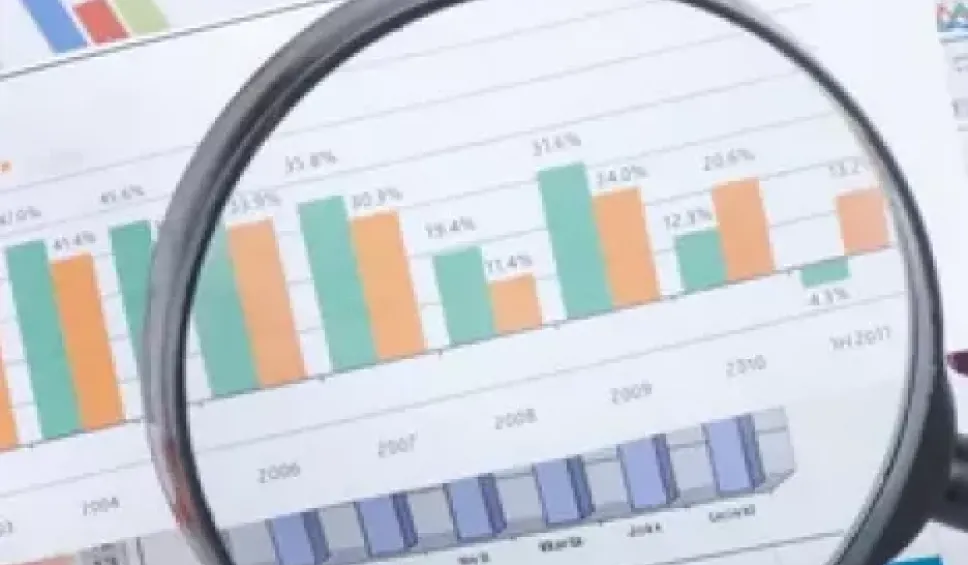
- Les chiffres du chômage et les prévisions économiques
-
Prévisions de croissance et d’emploi : prenant en considération le tournant austéritaire et
l’incertitude politique, l’OFCE revoit sa copie à la baisse.
Le 9 avril dernier, l’Observatoire Français des Conjonctures Économiques (OFCE) a révisé à la baisse ces prévisions de croissance du PIB pour 2025 de -0.3% par rapport à ces prévisions données à l’automne dernier.Pour l’OFCE, la croissance annuelle n’atteindrait que 0.5% et l’organisme de recherche de Sciences Po, prévoit par la même occasion une remontée plus rapide du taux de chômage qui passerait la barre des 8% au début de l’année 2026. Cet ajustement prévisionnel est expliqué par les incertitudes nationales et internationales. La croissance française de ces deux dernières années avait été tirée par la politique budgétaire de l’État et le commerce extérieur. Or au niveau national, l’incertitude politique, le vote d’un budget de rigueur et la fin progressive des politiques de soutien liées au COVID (aides à l’emploi, baisse des aides aux entreprises) auraient des effets négatifs en particulier sur les investissements des entreprises.
Au niveau international, le comportement imprévisible du gouvernement Trump en matière de tarifs douaniers gèle pour le moment et devrait modifier durablement à terme le commerce mondial. Au total, l’OFCE prévoit 245 000 destructions nettes d’emplois dans le secteur marchand d’ici fin 2026. Ainsi, les destructions d’emplois qui n’ont jamais été aussi brutales depuis plus de 10 ans (hors COVID) vont donc s’aggraver dans les prochains mois. Il est
alors indispensable de se préparer syndicalement à un accroissement encore plus important de plans
sociaux.
Encadré : Le mythe des emplois vacants
La droite et le patronat ont leur marronnier pour éviter de s’exprimer sur la remontée du chômage consécutive aux politiques austéritaires qu’ils promeuvent : les emplois vacants ! Pour eux le chômage tient à la volonté des demandeurs d’emploi et preuve en est qu’il existe des emplois inoccupés.
Les emplois dits « vacants », sont des postes libres, nouvellement créés, inoccupés, ou sur le point de se libérer, pour lesquels des démarches actives sont entreprises pour trouver un candidat convenable. Ils sont repérés par l’enquête trimestrielle Activité et conditions d’emploi de la main-d’oeuvre (ACEMO) de la DARES.
S’il est vrai que le taux d’emplois vacants est sur une tendance haussière depuis la fin des années 2010, il reste que leur nombre est plus de dix fois inférieur au nombre de personnes en recherche d’emploi. En effet au dernier trimestre 2024, sur les catégories ABC, le nombre de privé⋅e·s d’emploi était de 5 495 100 alors que le nombre d’emplois vacants était de 480 000. Même si les emplois vacants étaient tous pourvus, le chômage serait tout de même massif. De plus, une analyse qualitative de ces emplois libres, montrent que ce sont principalement des emplois dans des petites structures (moins de 9 salarié⋅e·s) et dans des secteurs où la pénibilité du travail est réputée importante comme la construction et l’hôtellerie-restauration. Enfin, la publication de la DARES trimestrielle relative aux emplois vacants ne précise ni le statut d’emploi, ni le type de contrat des emplois vacants concernés. Le recrutement souhaité peut donc correspondre à un contrat à durée indéterminée (CDI), un contrat à durée déterminée (CDD), ou à un emploi saisonnier, même de très courte durée.
Le patronat omet bien de dire que ces emplois libres sont finalement peu nombreux au regard de la population au chômage, possiblement pénibles, de très courte durée et ne peuvent donc être des solutions durables pour les privé⋅e·s d’emploi.
- Emploi et territoires
-
Vencorex : le Tribunal de commerce de Lyon rejette le projet de coopérative soutenu par la CGT.
Vencorex, le 10 avril dernier, le projet de reprise de l’activité sous forme de SCIC soutenu par la CGT a été écarté par le Tribunal de commerce de Lyon. Pour rappel, depuis décembre dernier, la CGT appelle d’urgence à la nationalisation de Vencorex. Ce site industriel d’extraction de sel de qualité unique en Europe permet d’alimenter des secteurs économiques hautement stratégiques de la défense, de l’industrie spatiale, du nucléaire ou du sanitaire.
Cette décision est alors un véritable scandale et constitue un gâchis considérable pour l’industrie du pays et même européenne. On ne peut que déplorer l’impossibilité quasiment systématique des projets coopératifs composés notamment de salarié⋅e·s à être pris en considération par les Tribunaux de commerce. En effet, ces derniers les disqualifient la plupart du temps au motif de l’indisponibilité immédiate des fonds. C’est finalement un repreneur chinois, Wanhua, dont le projet ne pérennisera que 10% des emplois qui a été retenu pour reprendre l’activité. Il faut maintenant craindre un véritable effet domino tant cette usine est en amont de plusieurs filières industrielles de premier plan. Le gouvernement de François Bayrou avait exclu toute participation de l’État au projet de SCIC pourtant soutenu par tous les acteurs du territoire. La CGT exhorte toujours le gouvernement à agir en faveur d’une nationalisation à minima provisoire pour que le projet de coopérative puisse aboutir avec l’arrivée possible et non prise en compte dans le jugement du Tribunal de commerce de Lyon d’un financeur indien.
- Les contours de l’emploi
-
Bilan et reconduction du CDD multi-remplacements
Le 18 mars dernier, la Direction Générale du Travail (DGT) a invité l’ensemble des Organisations Syndicales (OS) et patronales (OP) pour dresser un bilan de l’expérimentation du CDD multi-remplacements. Ce nouveau CDD se distingue du CDD classique dont l’objectif est de ne remplacer qu’un⋅e seul⋅e salarié⋅, en permettant de remplacer plusieurs salarié⋅e·s absent⋅e·s simultanément ou consécutivement.
Un document de synthèse a été discuté en séance dont l’élaboration et le contenu ont indigné toutes les OS. En effet le bilan de l’expérimentation repose sur un questionnaire confié par la DGT aux seules OP pour diffusion auprès de leurs adhérents ! Les salarié⋅e·s et leurs représentants n’ont donc pas été sollicité⋅e·s pour élaborer le bilan. La synthèse du questionnaire était alors biaisée d’avance en faveur de ce nouveau contrat. Quelques chiffres éclairent la teneur de l’enquête et la façon dont le patronat perçoit ce CDD :
-
25% des répondants n’avaient même pas utilisé le dispositif,
-
63 % des remplacements dans le cadre de l’utilisation du dispositif sont justifiés par le remplacement de salarié⋅e·s en congés payés (= implique un enchaînement prévisible d’absences).
-
En moyenne, 1 CDD multi-remplacements remplace 2.6 salarié⋅e·s.
-
66,3 % des participants à l’enquête ont affirmé que ce dispositif contribuait à diminuer le nombre de contrats.
-
81.3 % pour faciliter la gestion des ressources humaines.
-
13.9% pour tempérer le bonus-malus contrats courts.
La CGT a pointé les difficultés (d’ailleurs mentionnées dans le rapport) de classer un⋅e salarié⋅e occupant plusieurs emplois dans une grille notamment de rémunération, en particulier s’il s’agit d’un emploi cadre et un autre non-cadre dont les régimes de cotisations sont différents. Aussi, la CGT remarque que le dispositif prévoit l’affectation possible du/de la salarié⋅e sur plusieurs établissements d’une société qui peuvent avoir des conventions collectives différentes sans qu’il ne précise laquelle s’applique.
Enfin, la CGT a demandé à la DGT l’ajout des expressions des OS au rapport d’évaluation envoyé aux parlementaires afin de rééquilibrer le document. La DGT n’a pas répondu à notre demande et a donné un avis favorable à la reconduction de l’expérimentation CDD multi-remplacements.
Travail de plateforme : la CGT venue en nombre pour porter son projet revendicatif à l’Assemblée nationale
La Directive européenne relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme numériques publiée le 23 octobre 2024, impose à la France une transposition en Droit national d’ici au 2 décembre 2026. Dans cette perspective, une proposition de loi relative à la lutte contre l’ubérisation et le recours au faux statut de travailleuse et de travailleur indépendant⋅e par l’instauration d’une présomption de salariat a été déposée par la députée Danielle Simonnet et des député⋅e·s du Nouveau Front Populaire.
Pour promouvoir et échanger autour de ce texte, un colloque a été organisé le 6 mars 2025 à l’Assemblée nationale intitulé : « Vite, la présomption de salariat ! », auquel la CGT a été
Page 4 sur 5
particulièrement mise en avant et écoutée. L’événement comportait trois tables rondes, avec pour chacune d’entre elles une intervention CGT :
1) « La présomption de salariat du point de vue des ubérisé⋅e·s » : Ludovic Rioux, ancien livreur à vélo et membre de la Fédération CGT des transports ;
2) « La présomption de salariat du point de vue de l’Etat de droit » : Valérie Labatut, inspectrice du travail et membre du bureau national de l’USN-CGT TEFP ;
3) « La bataille politique et sociale pour faire appliquer la présomption de salariat » : Sonia Pélissier, élue à la CEC et pilote du Groupe de travail confédéral « Travailleur⋅ses non-salarié⋅e·s ».
En présence de député⋅e·s et sénateur·rice·s du NFP, représentant·e·s syndicaux·ales et associatif·ves, juristes, mais aussi et surtout travailleur·ses de plateformes, la CGT a exprimé son opposition au développement de l’utilisation dévoyée du statut d’entrepreneur individuel à des fins de substitution au statut de salarié. Elle a alors plaidé pour une véritable présomption de salariat collective pour l’ensemble des travailleur·euse·s de plateformes, s’opposant ainsi aux requalifications individuelles qui n’impliquent pas de requalifications automatiques pour l’ensemble de ces travailleur·euse·s.
La CGT considère la Directive européenne comme un progrès, bien que peu précise sur la mise en application de cette présomption. Saluant l’initiative de cette proposition de loi, elle a cependant souligné l’absence dans le texte de dispositions sur la gestion algorithmique du travail, alors que la Directive est le premier texte européen à traiter de l’impact de l’algorithme dans le cadre du travail. La CGT a alors porté la nécessité d’une transparence de la gestion algorithmique des travailleur·se·s, avec un droit de regard des organisations syndicales.
De nombreuses convergences fortes se sont ainsi dégagées des échanges :
- la mise en oeuvre d’une présomption de salariat forte
- la lutte contre un tiers-statut hybride entre salariat et auto-entreprise ;
- la disparition de l’Autorité de Régulation des Plateformes d’Emploi (ARPE), qualifiée de pseudo instance de négociation entre les plateformes et leurs travailleur·se·s, visant à les priver des droits issus de conventions collectives de branches applicables ;
- la protection des travailleur·se·s sans papiers, nombreux·se·s à subir la plateformisation ;
- l’accès aux droits à la protection sociale des travailleur·se·s de plateforme ;
- la régulation de la gestion algorithmique du travail et de la prise de décisions automatisée ;
- la nécessité de travailler toutes et tous ensemble, parlementaires, organisations syndicales, associations, société civile, à la création d’un rapport de force face au gouvernement, avec bien entendu une mobilisation massive des travailleur·se·s de plateforme partout en Europe.
Cet évènement a mis en exergue une CGT en phase avec les préoccupations et les nécessités des travailleur·se·s de plateforme de se voir rétabli·e·s dans leurs droits. Elle a ainsi été saluée comme un acteur incontournable dans la lutte contre les nombreux abus des plateformes multinationales, dont l’influence s’étend à une multitude de champs professionnels. - Emploi et transitions
-
Intelligence Artificielle au travail : une majorité d’actifs en font usage selon le baromètre de l’emploi et de la formation
Le 8 avril dernier, s’est tenue la présentation du 6ème baromètre de l’emploi et de la formation du Centre inffo, association sous la tutelle du ministère du Travail. L’édition de cette année s’est attachée
Page 5 sur 5
à rendre compte de l’usage de l’Intelligence Artificielle (IA) au travail en s’appuyant sur un sondage CSA/Centre inffo. Les résultats révèlent un usage par les actifs déjà important et une volonté de se former davantage à ces outils :
•
64% des actifs sondés ont déclaré être à l’aise avec l’usage des outils de l’IA comme Chat GPT.
•
53% des actifs interrogés utilisent l’IA dans le cadre professionnel principalement en soutien à de la recherche et à la rédaction de document.
•
78% estiment que l’IA va modifier profondément leur environnement de travail
•
72% estiment avoir besoin d’une formation en IA
La CGT revendique une prévention efficace des risques professionnels associés à l’IA pour l’ensemble des travailleur·ses et obtenir de nouveaux droits notamment celui de se former à ces nouveaux outils numériques. Aussi, la CGT considère que l’utilisation de l’IA doit être décidée collectivement et viser notamment des objectifs sociaux et environnementaux garantissant le bien-être humain.
→
Pour aller plus loin, voir le dossier IA de l’UGICT-CGT : https://ugictcgt.fr/themes/intelligence-artificielle/
→
L’exposé et les conseils de la CGT sur nos droits relatifs à l’IA au travail :
https://www.cgt.fr/actualites/france/intelligence-artificielle/lia-au-travail-tout-savoir-sur-ses-droits-en-16-questions
→
Sur la question de la substitution de l’IA à l’emploi, le rapport de la commission sur l’Intelligence Artificielle : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cge/commission-IA.pdf?v=1710339902