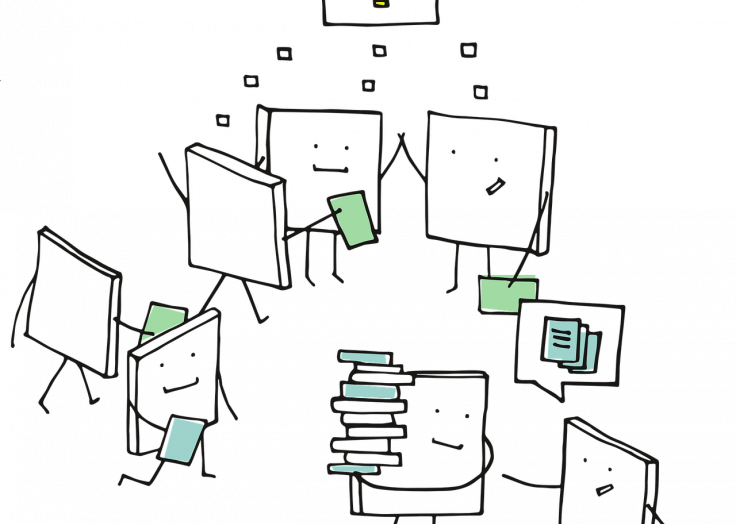- Ce qu’il faut retenir
-
- Le Premier ministre a annoncé le 15 juillet dernier un plan d’austérité de 44 milliards d’euros. Celui-ci repose essentiellement sur des baisses de dépenses publiques. Dans ce cadre, une des mesures phares du gouvernement est celle de la mise en œuvre d’une « année blanche » en 2026 qui doit permettre d’économiser 7,1 milliards d’euros.
- Une « année blanche » consiste à geler les prestations sociales indexées, les rémunérations des agents publics et le barème de certains prélèvements obligatoires.
- Cette mesure aura pour conséquence de réduire le niveau de vie des travailleur·ses, des privé·es d’emplois, des retraité·es et de leurs familles.
- Par ailleurs, elle revient à faire supporter une grande partie de l’ajustement budgétaire sur les retraité·es et sur les ménages les plus modestes.
- La CGT met à disposition un simulateur permettant à chacun et chacune de mesurer les effets des annonces de Bayrou sur ses revenus et son pouvoir d’achat.
- Qu’est-ce qu’une « année blanche » ?
-
Il faut rappeler que le Premier ministre a déjà passé en force par 49.3 son premier budget austéritaire en 2025, avec une baisse des dépenses publiques de 32 milliards d’euros et une hausse des prélèvements obligatoires de 21 milliards d’euros pour revenir à un déficit public de 5,4% du PIB en 2025[1]. Et celui-ci a déjà commencé à accentuer sa politique austéritaire en décidant d’un effort supplémentaire de près de 10 milliards d’euros sur les dépenses publiques depuis le début de l’année 2025.
Le plan du gouvernement actuel consiste à poursuivre une cure d’austérité d’une violence sociale sans précédent durant les quatre prochaines années pour revenir sous les 3% de déficit et stopper l’augmentation de la dette publique d’ici 2029. Pour cela, des cibles de déficit public à atteindre ont été annoncées pour les années à venir : 5,4% du PIB en 2025, 4,6% en 2026, 4,1% en 2027, 3,4% en 2028 et 2,8% en 2029.
Pour atteindre le déficit public visé en 2026, le Premier ministre a indiqué que les économies devraient être de 43,8 milliards d’euros. Surtout, celui-ci refuse de remettre en cause la politique de l’offre, dont l’échec est pourtant aujourd’hui bien documenté, et de faire contribuer les grandes entreprises et les ménages les plus riches au prétexte fallacieux qu’ils pourraient quitter le pays et ainsi affaiblir l’investissement, ce qu’une étude récente récuse[2]. Il souhaite que l’essentiel des économies soit fait sur la dépense publique et au détriment des classes populaires.
Pour cela, une des propositions faites par le gouvernement consiste à imposer une « année blanche » en 2026. On entend par « année blanche » le gel de l’ensemble des prestations sociales qui sont habituellement indexées sur l’inflation (minima sociaux, prestations familiales, allocations logement, pensions de retraites, allocations chômage, allocations adulte handicapé, bourses d’études), des rémunérations des agent·es de la fonction publique et des barèmes de prélèvements obligatoires.
Le gouvernement estime que cette mesure devrait rapporter 7,1 milliards d’euros aux finances publiques. Cette « année blanche » portera sur l’ensemble des prestations avec maintien des barèmes de 2025 en 2026. Le point d’indice de la fonction publique sera gelé. Les barèmes de l’IR et de la CSG sont également maintenus à leur niveau de 2025.
Concrètement, une « année blanche » aura pour conséquence de réduire le niveau de vie des travailleur·ses, des privé·es d’emplois, des retraité·es et de leurs familles. Ces pertes de pouvoir d’achat seront définitives. Les prestations sociales et la rémunération des agent·es public·ques ne vont donc pas suivre l’augmentation des prix[3]. Pour 2026, la Banque de France prévoit une inflation d’au moins 1,4 %, ce qui signifie qu’en euros constants, toutes les prestations sociales et les rémunérations des agent·s public·ques baisseront de 1,4 %.
Cela concernerait notamment :
- les bourses d’études pour les jeunes : pour un·e étudiant·e échelon 7, cela représente une perte de l’ordre de 90 euros par an ;
- l’allocation aux adultes en situation de handicap : pour une personne vivant seule et ne disposant pas d’autres ressources, cela signifie une perte de l’ordre de 175 euros par an ;
- le RSA : pour une personne seule ce serait une perte de l’ordre de 110 euros par an ;
- les pensions de retraite : pour une pension de 1500 euros par mois, ce devrait être une perte de l’ordre de 250 euros par an ;
- le traitement des fonctionnaires : pour un·e fonctionnaire rémunéré·e 2000 euros brut par mois, cela représenterait une perte de l’ordre de 330 euros par an.
Pour des millions de foyers qui n’arrivent déjà pas à boucler leurs fins de mois, c’est loin d’être un détail !
Par ailleurs, en bloquant les seuils de certaines prestations sociales, une « année blanche » peut exclure automatiquement les personnes qui en sont proches lorsque leur revenu augmente faiblement, même en dessous de l’inflation. C’est par exemple très sensible pour des allocations logement.
D’autre part, les barèmes de l’impôt sur le revenu (IR) et de la CSG ne seront pas revalorisés. Habituellement, ces barèmes évoluent en fonction de l’inflation. Par exemple, pour un·e travailleur·se dont le revenu évolue au même rythme que l’inflation, une revalorisation du barème de l’IR en lien avec l’inflation doit permettre que le montant de l’impôt sur le revenu dont il s’acquitte augmente au même rythme que ses revenus, de sorte que son taux d’imposition global reste identique[4]. En 2026, avec le gel du barème de l’IR, toute hausse des revenus égale ou inférieure à l’inflation donnera donc lieu à une hausse de l’impôt sur le revenu, ce qui n’aurait pas été le cas si le barème avait été indexé : certain·es travailleur·ses vont donc voir leur imposition augmenter car les euros supplémentaires qu’ils perçoivent sont au moins imposés au taux de leur dernière tranche qui est supérieur à leur taux moyen d’imposition ; d’autres vont passer une tranche supplémentaire à la suite de la hausse de leurs revenus ; et enfin certain·es qui n’étaient jusqu’à maintenant pas éligibles à l’impôt sur le revenu vont le devenir.
Cette « année blanche » est d‘autant plus inacceptable que le monde du travail a déjà subi de lourdes pertes de niveau de vie depuis la crise inflationniste, et alors que les profits et les dividendes ne cessaient de croître dans le même temps[5]. Par ailleurs, le gel des allocations à destination des personnes les plus modestes et les plus vulnérables est incompréhensible alors que le taux de pauvreté et les inégalités de revenus n’ont jamais été aussi élevés en France. En effet, une étude de l’Insee publiée en juillet dernier montre que le taux de pauvreté a atteint 15,4% en France en 2023, soit près de 10 millions de personnes, un record depuis que cet indicateur a été mis en place en 1996[6].
Pour appréhender l’impact de toutes ces mesures du budget Bayrou, et en particulier l’effet d’une « année blanche » sur le niveau de vie de tout un chacun, la CGT a développé un simulateur : https://www.cgt.fr/simulateur.
[1] Voir le dossier de presse « Loi de finances de 2025 : ce qu’il faut savoir ».
[2] Voir la note du Conseil d’analyse économique, rattaché à Matignon, intitulée « Fiscalité du capital : quels sont les effets de l’exil fiscal sur l’économie », remise au Premier ministre fin juillet.
[3] D’après les annonces faites par le Premier ministre, il n’y aura pas de mesures de revalorisations pour les fonctionnaires, mais les règles d’avancement dans les carrières sont maintenues pour l’année 2026.
[4] Et si ses revenus augmentent plus vite que l’inflation, alors son taux global d’imposition augmentera.
[5] Voir le mémo éco n°144 « Des versements de dividendes records pour les actionnaires du CAC 40 en 2024 ».
[6] Le seuil de pauvreté monétaire est fixé à 1288 euros par mois par unité de consommation.
- Un effort qui portera essentiellement sur les retraité·es et les ménages les plus modestes
-
Le Premier ministre assure qu’une « année blanche » permettrait de faire reposer l’effort d’économies sur toutes les catégories de français·es. C’est un énième mensonge. Une étude récente de l’OFCE s’est intéressée aux conséquences économiques et sociales d’un gel du montant de l’ensemble des prestations sociales indexées et du barème de l’impôt sur le revenu. Il en ressort que les effets d’une « année blanche » sont très hétérogènes en fonction du statut d’activité et du niveau de vie des ménages.
D’abord, le revenu disponible des ménages dont la personne de référence est retraitée diminuerait de 350 euros par ménage en 2026 (soit 1% de leur niveau de vie), de 70 euros par ménage pour les salarié·es (0,2%), de 100 euros par ménage pour les indépendant·es (0,2%), de 180 euros par ménage pour les privé·es d’emploi (0,6%) et de 160 euros par ménage pour les inactif·ves (0,6%). L’étude conclut ainsi que « les ménages comptant un ou plusieurs retraité·es devraient être les plus affectés par une « année blanche » ».
Par ailleurs, elle précise qu’en « pourcentage du niveau de vie, ce sont bien les ménages modestes qui verraient leur revenu le plus réduit par une « année blanche » ». En effet, ils seront davantage frappés en proportion de leur revenu disponible (baisse de 0,8% pour les plus modestes) que les ménages les plus riches (baisse de 0,3% pour les ménages les plus riches).
Le choix d’une « année blanche » n’est pas neutre et il ne s’agit pas que d’une mesure technique qui viserait à reporter le même budget d’une année sur l’autre pour les prestations sociales et les impôts : il conduit à faire supporter une grande partie de l’ajustement budgétaire sur les retraité·es et sur les ménages les plus modestes.