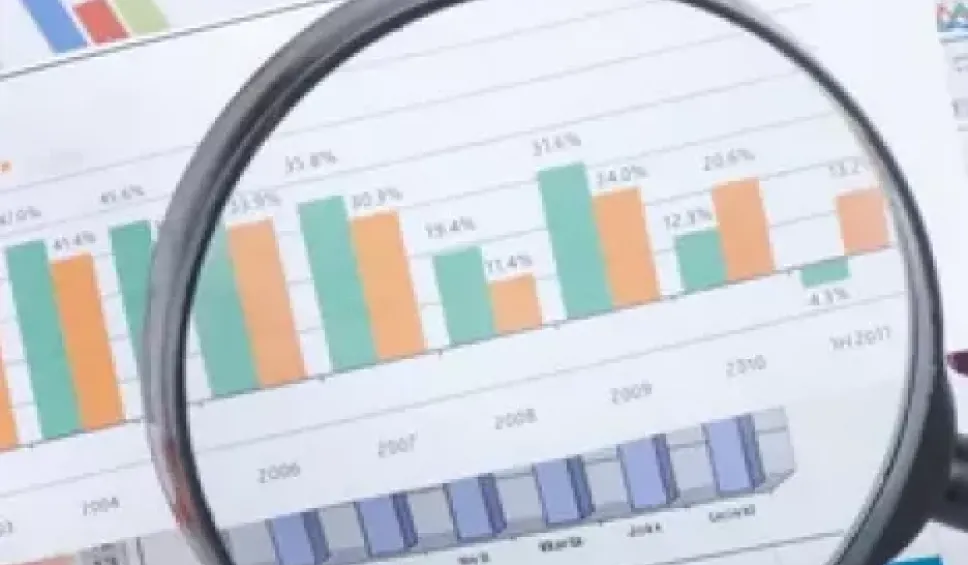
- Les chiffres du chômage et les prévisions économiques
-
Une hausse des plans sociaux….
La situation sociale et économique du pays est en plein déclin. La coordination des luttes de la CGT a établi une liste noire des plans de licenciements en France entre septembre 2023 et novembre 2024. Elle comprend actuellement 231 plans de suppression d’emplois sur la période dont 173 à caractère industriel. Les chiffres de l’URSSAF corroborent notre analyse, les redressements et liquidations judiciaires ainsi que les plans de sauvegarde de l’emploi sont en hausse depuis la crise COVID. Aussi, selon l’Agence pour la Garantie des Salaires (AGS) sur la récente période, entre les 3ème trimestres (T3) 2023 et 2024, le nombre de bénéficiaires de l’AGS a augmenté de 22.6% et le nombre d’affaires ouvertes a augmenté de 8,4%1 . Enfin, le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires dénombre 13 217 défaillances d’entreprises au T3 2024, en hausse de 14% par rapport au T3 2023 et de 46% par rapport au T3 2022.
1 https://www.ags-garantie-salaires.org/chiffres-cles.html
Encadré : Qu’est-ce qu’un plan social ?
Les Plans sociaux, formule utilisée pour éviter de parler de licenciements, ont de multiples facettes juridiques. On appelle dans un sens commun « les plans sociaux », les diminutions d’effectifs que mettent en place les entreprises pour répondre à des difficultés économiques temporaires ou pérennes. Ces diminutions d’emplois sont difficilement chiffrables du fait de la multiplicité des formes juridiques et des modalités de collectes de données de ces plans. Des modalités de ruptures collectives et individuelles peuvent permettre ces restructurations.
Il existe plusieurs modalités de ruptures collectives du contrat de travail : les Plans de Sauvegarde de l’Emploi (PSE), les Ruptures Conventionnelles Collectives (RCC) et les Accords de Performance Collective (APC).
Aussi certains employeurs déguisent des plans sociaux en une gestion prévisionnelle cachée des emplois dont l’objectif est de réduire fortement la masse salariale par le biais de dispositions individuelles (non-renouvellements de départ en retraite, ruptures conventionnelles individuelles, licenciements pour motifs personnels) face à des difficultés financières.
Cette stratégie de déguisement ou de mise en place de RCC et d’APC dans les entreprises en difficulté est voulue par les employeurs car le PSE est la modalité juridique la plus favorable pour les salarié∙es. En effet, cette dernière doit faire l’objet d’une validation par l’inspection du travail et permet aux CSE de négocier au mieux la préservation des emplois et les conditions de sortie des salarié∙es. Elle donne aussi accès aux personnes licenciées l’accès au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) qui garantit le salaire sur un an et ne les prive pas ensuite de leur accès à l’assurance chômage. En outre ce contrat donne un accès prioritaire à la formation professionnelle.
…et des destructions d’emplois spectaculaires à venir
La coordination des luttes a recensé 63 001 emplois menacés ou supprimés dont 27 059 dans l’industrie. Si on tient compte des emplois indirects et induits par l’industrie, ce chiffre monte entre 113 543 et 176 720 emplois menacés ou supprimés. Aussi, l’OFCE prévoit 143 000 suppressions de postes en 2025 et une remontée du taux de chômage à 8% pour la fin de l’année prochaine2.
2 https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/pbrief/2024/OFCEpbrief137.pdf P.20
Page 3 sur 5
Ces destructions d’emplois et ce retournement de l’activité économique futur se produisent au moment où se discute à l’Assemblée nationale un budget de l’Etat en berne pour 2025 présageant une possible récession à venir.
→
Compte-tenu de la dégradation rapide de l’emploi et de la désindustrialisation du pays, la CGT appelle à la mobilisation nationale pour l’emploi et l’industrie, le 12 décembre 2024 ; (Suivez ce lien pour plus d’informations). - Emploi et territoires
-
Destruction d’emplois : des conséquences durables dans les territoires
Les destructions d’emplois se concentrent dans des territoires industrialisés parfois éloignés des grandes métropoles à l’instar des industries agroalimentaires bretonnes ou des anciens sites manufacturiers des Hauts-de-France. Ces destructions d’emplois créent des drames importants dans les territoires du fait des emplois induits détruits par la disparition de sites industrielles. L’INSEE nous montre que pour 1 emploi industriel détruit, 3 le sont sur le territoire concerné et créé alors des drames sociaux locaux difficilement réversibles. Pour mesurer l’ampleur de ce phénomène, en mars dernier, France stratégie a publié une étude sur les conséquences de long terme de la perte d’emploi à la suite de la crise de 2007 dans les territoires3. L’étude distingue deux types de territoires ceux dont la diminution du taux d’emploi a été supérieure ou égale à 3% durant la crise 2008-2009 et ceux dont la diminution a été inférieure à 3%. Les premiers ont été durablement touchés au point qu’en 2019, 88% d’entre eux n’avaient pas retrouvé le niveau d’emploi de 2007. Pour les seconds, ce chiffre atteint tout de même 44%. L’étude
3 https://www.strategie.gouv.fr/publications/rebond-local-apres-pertes-demplois-massives
Page 4 sur 5
propose aussi de comparer les dynamiques de taux d’emploi par catégorie de territoires similaires sur le plan économique avant la crise (2008-2009) mais affectés différemment par celle-ci (< ou ≥ 3% de baisse sur le taux d’emploi). Le constat est que plus de 10 ans après, les dynamiques de taux d’emploi continuent à être très divergentes selon le degré de dégradation économique par la crise (cf graphique ci-dessus).
- Les contours de l’emploi
-
Le CDIE : une expérience prolongée malgré un rapport accablant de l’IGAS4
Le CDI aux fins d’employabilité permet aux entreprises de travail à temps partagé (ETTP) de mettre à disposition des salarié∙es à des entreprises utilisatrices sans avoir à justifier d’un quelconque motif de recours, sans limite de durée, sur tous types de postes, y compris sur les emplois liés à l'activité normale et pérenne de l'entreprise utilisatrice, sans risquer la requalification en CDI. C'est une différence importante avec les missions d’intérim et le CDI intérimaire contractualisé avec des Entreprises de Travail Temporaire (ETT), dont le recours est encadré et respecte le cadre légal et conventionnel du travail temporaire. En effet, contrairement aux ETT, les ETTP ne font pas partie de la branche du travail temporaire et les salarié∙es ne peuvent donc pas bénéficier des avantages sociaux liés au travail intérimaire comme l’accès au fonds d'action sociales (FASST) et à tous les dispositifs de formation de la branche.
En l’état, l’IGAS préconise de ne pas pérenniser l’expérimentation du CDIE dans son cadre actuel". "En effet, l’inscription du dispositif dans la loi pourrait conduire non seulement à une substitution du CDIE au CDI intérimaire, mais aussi à une externalisation non maîtrisée de l’emploi, remettant en cause le CDI comme la forme normale et générale de la relation de travail » !
État des lieux de l’emploi par les plateformes numériques en France
Le 21 novembre dernier, la DARES a publié une analyse sur le profil et les conditions de travail des travailleurs des plateformes5. En 2023, l’étude montre que 2 % des personnes en emploi sont des indépendant∙es qui accèdent à leur clientèle via une ou plusieurs plateformes numériques. Ces personnes sont plus diplômées que les autres catégories d’emploi ; 76 % sont au moins titulaires du bac, contre 69 % des salariés et 70 % des autres indépendants. Le plus gros des effectifs de ces travailleur∙ses (18%) sont des intermédiaires et prestataires de services (courtier∙e en assurance, agent∙e immobilier, commercial∙e, conseiller∙e/consultant∙e). En ce qui concerne les conditions de travail, la plateforme organise au moins une partie du travail pour 44 % de ces travailleur∙ses. Ils et elles sont 58% à voir leur travail noté par des client∙es ou le public (note chiffrée, étoiles, smileys, etc.), contre 20% des salarié∙es et 29% des autres indépendant∙es. Le volume horaire de travail est nettement supérieur pour ces travailleur∙ses : 61% travaillent plus de 40H/semaine, 88% travaillent le week-end et 75% soir et horaire de nuit. - Emploi et transitions
-
Table-ronde à Sciences Po Paris sur le sujet « emploi et environnement »
4 https://www.igas.gouv.fr/sites/igas/files/2024-10/Rapport%20Igas%20-%20CDIE.pdf
5 https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/les-travailleurs-de-plateforme-quels-profils-et-quelles-conditions-de-travail
Page 5 sur 5
Le 21 novembre dernier, la CGT était invitée à une table ronde à Sciences po Paris sur le sujet : « Vers une transition juste en France : emploi, travail et transitions environnementales ». Mathilde Guergoat-Larivière et Nathalie Moncel, deux chercheuses en pointe sur la problématique « emploi / environnement » ont présenté leurs travaux qui a suscité le débat sur les conséquences de la transition environnementale sur la qualité des emplois. Contrairement à une idée reçue, les emplois « verts » (participant à la transition) sont en majorité peu qualifiés et moins bien rémunérés que dans le secteur dit « marron » (carboné). Aussi, les chercheuses mais aussi les discussions avec les participant∙es ont souligné que les résultats de recherche dans tous les pays tendent à montrer que ces métiers de la transition sont peu attractifs ce qui constitue un véritable obstacle à la transition. La CGT a souligné que les questions de l’emploi, des conditions de travail et de rémunération devaient alors avoir une position centrale pour la permettre. Nous avons notamment pu exposer la nécessité de mettre en place d’urgence une Sécurité sociale professionnelle et environnementale pour préserver les revenus des travailleur∙ses qui s’orientent vers les secteurs verts et permettre ainsi de lever l’obstacle à l’impérative transition.
- Du côté des branches
-
Emploi des « Séniors » : vers une future obligation de négocier dans les branches
Le 14 novembre dernier s’est tenue à l’UNEDIC, la séance conclusive de la négociation sur l’emploi des « Séniors ». Elle a été la prolongation de la négociation “Pacte de la vie au travail” qui avait déjà mobilisé notre organisation syndicale entre novembre 2023 et avril 2024 et s’était soldée par un échec puisqu’aucune organisation syndicale n’avait souhaité signer la proposition patronale. Ce deuxième acte semble donc plus fécond pour le patronat puisqu’il a réussi à obtenir les premières faveurs de la CFDT, de FO, de la CFE-CGC et de la CFTC. Ce futur accord n’obtient pas d’avancée notable sur le plan interprofessionnel et relègue finalement la négociation aux branches. En effet, il demande notamment aux branches de négocier sur le recrutement des salarié∙es expérimenté∙es, la transmission des savoirs et des compétences, le maintien dans l’emploi et l’aménagement des fins de carrière dont la retraite progressive. Pour le patronat, l’emploi des salariés séniors ne peut s’envisager qu’à l’appui d’un nouveau contrat et de nouvelles exonérations avec des reculs pour les salarié⋅es.
Ce contrat, CDI senior, consiste à embaucher un salarié de 60 ans et plus inscrit à France Travail. A ce titre, l’employeur sera exonéré de la contribution patronale de 30% sur le montant de l’indemnité de la mise à la retraite. Le salarié sera contraint de remettre à l’employeur le document transmis par l’assurance retraite mentionnant la date de sa retraite à taux plein.
Ainsi, l’employeur pourra procéder à la retraite d’office du/de la salarié⋅e à l’obtention de son taux plein. Ce contrat constitue une véritable aubaine pour le patronat d’embaucher des salarié⋅es a minima et de surcroît de bénéficier d’exonérations de cotisations.
Alors que la ministre du travail invitait les acteurs sociaux à travailler sur l’emploi et le maintien de l’emploi des séniors et à assouplir les conditions d’accès à la retraite progressive, force est
de constater que cet accord n’est nullement contraignant pour les employeurs et ne garantit aucun droit pour les salarié⋅es.
En cas d’application de l’accord, la confédération outillera alors les branches pour négocier les meilleurs accords possibles pour tous les salarié∙es expérimenté∙es.