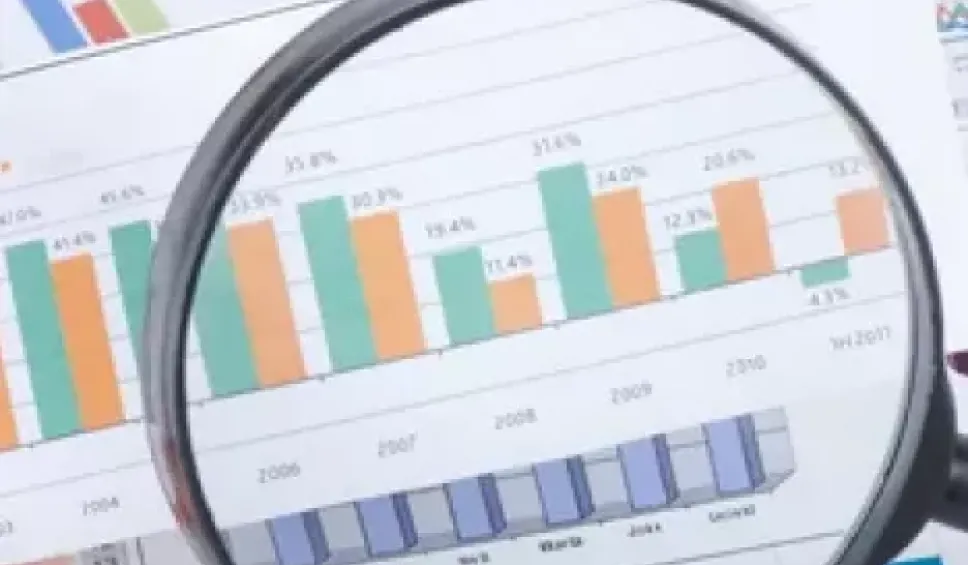
A chaque campagne politique ou médiatique autour des projets de loi de finances, les mêmes discours populistes reviennent : pour faire face au déficit, il faut réduire les dépenses publiques à travers le nombre de fonctionnaires qui ne cesserait de croître de façon exponentielle et non maîtrisée.
-
Trop de fonctionnaires ?
-
En réalité, dans les tableaux comparatifs, on trouve souvent le poids de l’emploi public au regard du PIB ce qui est forcément fluctuant et conjoncturel ou le rapport emploi-public/population sans tenir compte de l’organisation régalienne des Etats, ni du statut réel des agent.es et de leur proportion dans l’emploi public.
La population française a augmenté de 7,21% depuis 2011 alors que l’emploi public n’a quant à lui augmenté que de 4,51%. De plus, l’évolution de la population, notamment son vieillissement, a des conséquences sur les besoins en services publics. Les enjeux grandissants comme celui de l’environnement ont également un impact sur ceux-ci.
Le nombre d’agent.es public.ques répond à des besoins identifiés et à des missions de plus en plus développées, augmente mais proportionnellement moins que le nombre de postes non pourvus. Ainsi 11% des postes ouverts dans la Fonction publique d’Etat sont non pourvus.
En 2011, un.e candidat.e admis.e pour 12,4 candidat.es et seulement pour 4,6 candidat.es en 2023.
Par ailleurs, la part d’agent.es non titulaires ne cesse de croître, par vision « court-termiste » de l’Etat et parce que les recrutements de fonctionnaires peinent à trouver des candidat.es.
Sur les 5,8 millions d’emplois pris en référence, 1,8 million sont des agent∙es contractuel.les. Parmi ceux et celles-ci 58% ont un contrat d’une durée inférieure à 1 an et seulement 12% supérieur à 3 ans (rapport annuel sur l’état de la fonction publique)
Emilien Ruiz, professeur et chercheur en sciences politiques, affirmait dans son ouvrage « Trop de fonctionnaires ? Histoire d’une obsession française » que l’augmentation du nombre d’agent∙es public∙ques répondait bien à l’élargissement des missions des services publics, et donc des besoins de la population, et non pas à un suremploi brutal d’agent∙es pour étoffer les services publics.
France Stratégie, dans son rapport paru en décembre 2024 (« Travailler dans la Fonction Publique, le défi de l’attractivité »), comme la Direction Générale de l’Administration de la Fonction Publique dans son rapport annuel de la fonction publique pour l’année 2025, montrent que si le nombre d’agent∙es public.ques augmente d’environ 0,4% par an depuis 2011, principalement par le recours à des agent∙es non titulaires d’ailleurs, la part de l’emploi public dans l’emploi total a profondément diminué. Cette part était d’un peu plus de 22% en 1990 et représente moins de 20% en 2023. Il manque donc plus de 500 000 agent∙es public.ques.
-
L’emploi public pèse trop sur le budget de l’Etat ?
-
C’est un leurre, d’autant plus lorsque l’on considère d’autres facteurs :
- Le gel du point d’indice de manière régulière et répétée depuis 2010,
- l’absence de refontes des grilles indiciaires type des catégories C, B et A au profit de mesures quasi exclusivement catégorielles ont participé à une « dévalorisation » ou à un manque d’attractivité des emplois dans la fonction publique.
- À volume de travail identique, les agent∙es de la fonction publique perçoivent une rémunération nette moyenne inférieure de 3,7 % à celle de leurs homologues du secteur privé, malgré leur âge et leur niveau de diplôme en moyenne plus élevés. Cet écart leur était favorable en 1995, mais le salaire net moyen du secteur privé a ensuite progressé plus vite que celui de la fonction publique, si bien qu’il le dépasse depuis 2013.
En 2023, le salaire net en euros constants des agent.es de la Fonction publique a diminué de 0,7%.
En 2023, dans le public, salaire net moyen 2652 euros net par mois, pour 2735 euros net moyen dans le privé. Alors que, 43% des agent∙es public∙ques ont un niveau licence, 28% dans le privé.
Dans l’Éducation nationale, l’impossibilité de pourvoir l’ensemble des postes par concours entraîne une augmentation des tensions sur les capacités de remplacement.
À la rentrée 2024, les médias ont ainsi fortement relayé :
- l’incapacité à garantir la présence d’un.e enseignant.e « dans chaque classe »,
- la perte d’heures de cours,
- la hausse du turnover,
- et le recours croissant à des contractuel.les moins formé.es,
- avec le risque d’une dégradation du service rendu aux élèves dans certains territoires face à la stabilité du nombre d’élèves du premier degré,
- le nombre de postes d’enseignant.es ouvert (pas forcément pourvus) est identique entre 2008 et 2025. Cependant, la démographie n’est pas linéaire sur l’ensemble du territoire et la désertification des territoires ruraux s’est accompagnée, dans le même temps, de la fermeture de 7500 écoles du premier degré (maternelles et élémentaires) induisant une augmentation des effectifs par classe et des regroupements qui sont source d’augmentation des temps de trajets des élèves, donc d’une dégradation de la réponse aux besoins pour une partie des enfants.
Dans le secteur de la santé, en 2024, la Cour des comptes fait le bilan des réductions du nombre de lits à l’hôpital.
Elle considère que de 2000 à 2022 ces fermetures résultent de choix de transferts de lits de soins de longue durée de l’hôpital vers les EHPADs jusqu’en 2023, puis principalement de progrès de techniques médicales permettant le développement de l’ambulatoire.
Mais depuis la crise sanitaire du Covid, ces fermetures sont plutôt attribuées à « la conséquence d’une contraction subie des capacités d’accueil, du fait du manque de personnels soignants ».
En 2022, 21 % des lits de l’AP-HP étaient fermés, dont près de 70 % pour manque de personnels.
Tout cela a des conséquences sur la qualité du service public rendu aux usagères et usagers d’une part mais aussi sur les conditions et qualité de vie au travail des agent∙es qui les servent.
En définitive, dire que l’Etat est obèse est un argument populiste qui vise à diviser les travailleuses, travailleurs et privé.es d’emploi, qui ne repose sur aucun élément objectivable et qui participe à une volonté de détruire notre modèle social et sociétal.
Défendre notre vision humaniste de la société et nos services publics passe donc aussi par la défense de leurs modes de financement.
Les annonces budgétaires et la prévision de suppressions de postes dans la Fonction publique constituent un nouveau coup de poignard pour des services publics déjà à l’os. Au contraire, pour la CGT, il nous faut des moyens à la hauteur de la réponse aux besoins.
Note du Pôle Prospective et Territoires avec le concours de l’UFSE-CGT.
